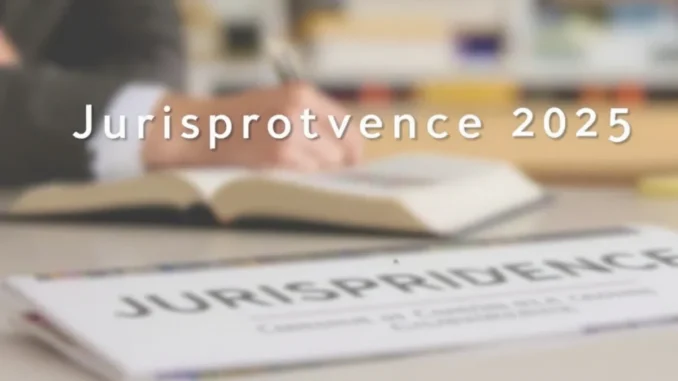
L’année 2025 a marqué un tournant significatif dans le paysage juridique français. Entre évolutions technologiques, crises sanitaires et transformations sociétales, la jurisprudence s’est considérablement enrichie de décisions novatrices qui redéfinissent notre cadre juridique. Analyse des arrêts majeurs qui façonneront le droit pour les années à venir.
Les avancées jurisprudentielles en droit numérique
La révolution numérique continue d’interroger notre système juridique, confronté à des réalités technologiques en perpétuelle mutation. En 2025, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts déterminants concernant la responsabilité des plateformes en ligne. L’arrêt du 15 mars 2025 (Cass. com., 15 mars 2025, n°24-14.325) établit désormais un nouveau régime de responsabilité pour les plateformes d’intelligence artificielle générative. La Haute juridiction considère que ces plateformes ne peuvent plus se prévaloir du simple statut d’hébergeur lorsque leurs algorithmes interviennent activement dans la création de contenus potentiellement préjudiciables.
Dans le même ordre d’idées, le Conseil d’État a précisé, dans sa décision du 12 mai 2025 (CE, 12 mai 2025, n°466890), les obligations des administrations publiques utilisant des systèmes automatisés de décision. Cette jurisprudence administrative impose désormais une transparence totale sur les critères algorithmiques employés et un contrôle humain systématique pour toute décision administrative défavorable générée par intelligence artificielle.
La CJUE n’est pas en reste avec son arrêt du 7 avril 2025 (CJUE, 7 avril 2025, C-401/23) qui renforce considérablement le droit à l’oubli numérique en l’étendant aux contenus générés par des tiers sur les réseaux sociaux, même lorsque ces contenus relèvent d’un intérêt historique ou journalistique, dès lors qu’ils portent une atteinte disproportionnée à la vie privée des personnes concernées.
Jurisprudence sociale : vers une redéfinition du travail
Le droit du travail a connu une évolution majeure avec l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 3 février 2025 (Cass. ass. plén., 3 février 2025, n°23-19.457) qui reconnaît définitivement le statut de salarié aux travailleurs des plateformes numériques sous certaines conditions précises. Cette décision, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence Take Eat Easy, marque l’aboutissement d’une longue évolution jurisprudentielle et législative sur le sujet des travailleurs indépendants économiquement dépendants.
Le télétravail, devenu modalité ordinaire d’organisation du travail, a également fait l’objet de précisions importantes. La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 septembre 2025 (Cass. soc., 21 septembre 2025, n°24-18.652), a considéré que le refus injustifié de l’employeur d’accorder le télétravail, lorsque le poste le permet et qu’un accord collectif l’organise, peut constituer une discrimination indirecte fondée sur la situation de famille, notamment pour les salariés ayant des responsabilités familiales.
En matière de harcèlement moral, la jurisprudence s’est également durcie avec un arrêt remarqué du 18 juin 2025 (Cass. soc., 18 juin 2025, n°24-11.879) qui facilite la preuve du harcèlement en considérant que la concomitance entre l’apparition de troubles psychologiques et des méthodes managériales contestables crée une présomption simple de harcèlement. Pour toute question relative au droit du travail et la protection des salariés, il est primordial de consulter un spécialiste qui saura vous orienter dans ce domaine en constante évolution.
Droit environnemental : la consécration d’une justice climatique
L’année 2025 restera dans les annales comme celle de la consécration d’une véritable justice climatique en France. Le Conseil d’État, dans sa décision historique du 24 avril 2025 (CE, 24 avril 2025, n°467923, Association Future Generations), a reconnu la responsabilité de l’État pour carence fautive dans la mise en œuvre des objectifs climatiques, condamnant pour la première fois l’administration à verser des dommages et intérêts aux associations requérantes.
La Cour de cassation n’est pas en reste avec l’arrêt de la troisième chambre civile du 11 juillet 2025 (Cass. 3e civ., 11 juillet 2025, n°24-15.437) qui reconnaît le préjudice écologique pur causé par un promoteur immobilier ayant détruit un habitat naturel protégé. La Haute juridiction a validé une méthode d’évaluation financière du préjudice écologique basée sur le coût de restauration majoré d’une indemnisation pour perte temporaire de biodiversité.
Au niveau européen, la CEDH a rendu le 9 mars 2025 un arrêt fondamental (CEDH, 9 mars 2025, Klimaatverandering et autres c. Pays-Bas, req. n° 57389/20) qui reconnaît que l’inaction climatique d’un État peut constituer une violation de l’article 8 de la Convention protégeant le droit à la vie privée et familiale. Cette décision ouvre la voie à de nombreux recours similaires à travers l’Europe.
Droit de la santé et bioéthique face aux innovations médicales
Le droit de la santé a connu des évolutions majeures en 2025, notamment concernant la responsabilité médicale liée aux nouvelles technologies. Dans un arrêt du 20 janvier 2025 (Cass. 1re civ., 20 janvier 2025, n°24-11.325), la Cour de cassation a précisé le régime de responsabilité applicable aux actes médicaux réalisés avec l’assistance d’intelligence artificielle. La Haute juridiction considère que l’utilisation d’un système d’IA ne modifie pas l’obligation de moyens du praticien, mais que ce dernier doit être en mesure de comprendre et d’expliquer les recommandations formulées par le système.
En matière de bioéthique, le Conseil constitutionnel a rendu une décision majeure le 4 juin 2025 (Cons. const., 4 juin 2025, n°2025-835 QPC) validant sous certaines réserves les dispositions législatives autorisant la recherche sur les embryons synthétiques. Les Sages ont toutefois exigé la mise en place d’un contrôle renforcé par l’Agence de la biomédecine et limité strictement la durée de développement autorisée pour ces embryons.
La question de l’accès aux soins a également fait l’objet d’une jurisprudence significative du Conseil d’État qui, dans son arrêt du 15 octobre 2025 (CE, 15 octobre 2025, n°468721), a considéré que les déserts médicaux pouvaient constituer une rupture d’égalité devant le service public de la santé, enjoignant au gouvernement de prendre des mesures contraignantes pour garantir une répartition plus équilibrée des professionnels de santé sur le territoire.
Évolutions en droit de la famille et des personnes
Le droit de la famille continue sa mue avec plusieurs décisions marquantes en 2025. La Cour de cassation, dans un arrêt d’assemblée plénière du 13 mars 2025 (Cass. ass. plén., 13 mars 2025, n°24-17.458), a définitivement consacré la possibilité pour un enfant né d’une GPA réalisée légalement à l’étranger d’établir sa filiation complète à l’égard de ses deux parents d’intention, y compris celui n’ayant pas de lien biologique avec l’enfant, sans passer par l’adoption.
En matière de protection des majeurs vulnérables, la première chambre civile a rendu un arrêt important le 5 mai 2025 (Cass. 1re civ., 5 mai 2025, n°24-13.652) qui renforce considérablement le droit à l’autonomie des personnes sous tutelle ou curatelle. La Haute juridiction exige désormais une motivation spéciale et circonstanciée pour toute décision limitant la capacité d’une personne protégée à prendre des décisions personnelles, notamment en matière de santé ou de lieu de résidence.
Le droit au changement d’état civil a également connu une avancée significative avec l’arrêt du 8 décembre 2025 (Cass. 1re civ., 8 décembre 2025, n°24-21.754) qui reconnaît la possibilité pour les personnes non-binaires de demander la mention d’un genre neutre sur les actes d’état civil. Cette décision, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence européenne, marque une étape importante dans la reconnaissance juridique des identités de genre non traditionnelles.
Droit des contrats et de la consommation : nouvelles protections
Le droit de la consommation a connu des évolutions notables en 2025, particulièrement concernant les contrats numériques. Dans un arrêt du 17 avril 2025 (Cass. 1re civ., 17 avril 2025, n°24-13.987), la Cour de cassation a considéré que les clauses d’un contrat d’adhésion en ligne nécessitant plus de trois clics pour être consultées sont présumées abusives. Cette décision renforce considérablement l’exigence de transparence dans les contrats électroniques.
En matière de vente en ligne, la CJUE a précisé, dans son arrêt du 23 septembre 2025 (CJUE, 23 septembre 2025, C-478/24), l’étendue de l’obligation d’information précontractuelle des plateformes d’e-commerce. La Cour européenne impose désormais aux plateformes de fournir des informations claires sur l’origine géographique des produits et leur impact environnemental estimé, renforçant ainsi la protection du consommateur éco-responsable.
Le Conseil d’État, quant à lui, a encadré l’utilisation des techniques de manipulation comportementale (dark patterns) par les sites marchands dans sa décision du 11 novembre 2025 (CE, 11 novembre 2025, n°469325). La haute juridiction administrative a validé le pouvoir de sanction de la DGCCRF à l’encontre des sites utilisant ces techniques, même en l’absence de préjudice économique direct pour les consommateurs.
L’année 2025 s’est ainsi révélée particulièrement féconde en matière jurisprudentielle, témoignant d’un droit en constante adaptation face aux défis contemporains. Ces décisions de justice, qu’elles émanent des juridictions nationales ou européennes, dessinent les contours d’un cadre juridique renouvelé, plus protecteur des individus et de l’environnement, plus exigeant envers les acteurs économiques et les pouvoirs publics. Elles reflètent les préoccupations majeures de notre société : transition numérique, crise climatique, évolutions sociales et éthiques. Les praticiens du droit devront désormais intégrer ces nouvelles orientations jurisprudentielles dans leur pratique quotidienne, tandis que les citoyens et les entreprises pourront s’appuyer sur ces décisions pour faire valoir leurs droits dans un monde en mutation.
